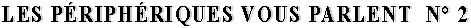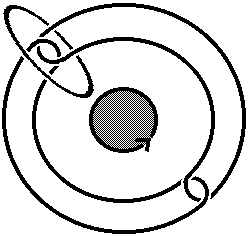|
« Il faut que paysannerie continue » |
| Premières réponses |
 |
Photo Florent Maillot |
Devenir capable de...
La première semaine de mai, Génération Chaos 2 était à l'Université Libre de Bruxelles. Enseignante de philosophie, je m'étais improvisée « contact » c'est-à-dire que mon nom avait été utilisé dans la demande de soutien matériel auprès des autorités académiques, et que j'avais écrit, pour présenter l'entreprise aux étudiants et chercheurs qui en ignoraient tout, le texte suivant :
- « Quand on a, comme moi, la quarantaine bien sonnée, un métier enfin stable après un peu de galère, une maison, etc., on a tendance à se demander : mais où sont les jeunes qui devraient faire intrusion, nous heurter, nous imposer des perspectives et des exigences inattendues ? Nous forcer à vieillir et à rajeunir à la fois, bref nous forcer à bouger ? Surtout lorsqu'on travaille à l'Université, qu'on est censé transmettre un savoir, une expérience qui rendrait ceux et celles à qui on s'adresse capables de faire autre chose que de survivre dans ce monde chaotique, où l'on nous dit que rien ne sera plus comme avant mais où on parle surtout adaptation, soumission aux demandes du marché, résignation à devenir toujours plus utilisables, malléables, disponibles.
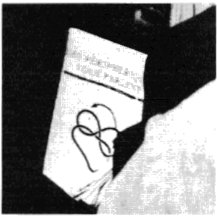 |
Photo Florent Maillot |
- Et voilà que se pointe Génération Chaos et un journal Les périphériques vous parlent avec cette devise : “Car la fondation d'un savoir est que la jouissance de son exercice est la même que celle de son acquisition”. Ils sont étudiants-acteurs, et ils nous demandent : “que faites-vous ?”, “quel rapport au savoir nous inoculez-vous, celui qui nous permettra de vivre le chaos, ou seulement d'y survivre, accrochés au rêve d'une stabilité perdue ?”. Ils nous disent : “nous apprenons à être acteurs, et c'est difficile, difficile de cesser d'être seulement interprètes des stéréotypes et mots d'ordre que l'on croit siens. Mais vous, les enseignants, êtes-vous interprètes ou acteurs de ce que vous êtes censés transmettre ?”
Intrusion inattendue, inquiétante, qui fait vieillir et rajeunir. Plus de satisfaction partenalistico-maternaliste quant à ces jeunes qui, enfin, suivraient nos traces. Au pied du mur. Ils nous demandent ce que nous sommes en train de faire, dans la routine. Quelles illusions, quelles impuissances, quelles soumissions transmettons-nous avec la meilleure des bonnes volontés ?
L'université, usine à chômeurs ?, grande école de formation pour une élite “vraiment professionnelle” ? Chômeurs, élites, il s'agit chaque fois de rôles écrits d'avance, à interpréter. Devenir capables de devenir acteurs ? C'est tout un travail, qui met effectivement étudiants, enseignants, chercheurs, à égalité. Dans la perplexité. Comment on fait pour se réveiller ?
Génération Chaos a inventé un spectacle qui n'en est pas un. Parce qu'il n'a pas été conçu puis appris- répété, mais crée de façon telle que, effectivement, la jouissance du devenir-capable d'être acteur soit la même que celle de l'exercice du savoir-être acteur. Il a été inventé comme un “agent-catalyseur” pour susciter le brisement du rôle de spectateur-consommateur, passif, cynique, désespéré, “à qui on ne la fait plus”. Un “spectacle”, conçu pour réveiller, pour secouer, pour mettre en branle et qui devra se prolonger par un vrai travail “politique” au sens où la politique c'est d'abord l'invention des manières de vivre ensemble. Comment vit-on ensemble, à l'université, lorsque certains appartiennent à la “génération chaos” et que les autres croient qu'ils savent et savent ce qu'ils ont.
Se réveiller, c'est d'abord se saisir de l'opportunité, même fragile, même ténue, de se réveiller. Le chaos n'est pas la crise en ce qu'il crée le défi de cesser de croire que “les choses s'arrangeront” qu'il faut avoir confiance. Comment on fait pour cesser d'avoir confiance sans désespérer ? C'est ce dont nous pouvons commencer à devenir capables, Mardi 3 et Mercredi 4 »
Ce que j'ignorais, lorsque j'ai écrit ce texte, c'est que, à la mi-avril, les étudiants de Bruxelles se sont soudain mis en mouvement. À la surprise de tous et à la réjouissance de plus d'un. « Faut-il une révolution tous les vingt cinq ans ? », demandait l'un de leurs tracts. Mais avec humour, car il ne s'agissait plus des étudiants politisés de 68 : le mouvement avait été lancé par les représentants étudiants au Conseil d'Administration (une « conquête » de 68), témoins scandalisés de l'impuissance de ce conseil à remplir sa fonction. Le détonateur avait été un plan de restriction budgétaire dont chacun savait qu'il ne serait discuté que pour la forme, puis qu'on se soumettrait, comme d'habitude.
 |
Photo Florent Maillot |
Le plan a été retiré à la fin de cette première semaine de mai. Les étudiants ont gagné, mais il est encore bien difficile de savoir ce qu'ils ont gagné. Mais, à cette occasion, j'ai pu - et je parle ici en mon nom - mesurer le contraste entre ce mouvement, explosif, inventif, mais limité par nature et décision aux objectifs qui avaient suscité l'explosion, et le travail qu'implique et que proposaient les membres du Laboratoire de Changement. Toute mise en mouvement traduit et amplifie bien sûr l'hétérogénéité du milieu où elle se produit. En l'occurrence, il y avait bien sûr les indifférents, ceux qui, si l'Université était en grève, restaient chez eux pour travailler (les examens étaient tout proches). Il y avait ceux qui s'étaient mis en mouvement, et vivaient au jour le jour les mutations du rapport de force engagé avec les autorités. Et puis il y avait ceux, très minoritaires, qui espéraient, n'osaient espérer, refusaient d'espérer, que d'autres problèmes seraient posés, que l'on pourrait passer de la résistance à l'invention. Ce sont ceux-là, et ceux-là seuls, qui sont venus et revenus, qui ont participé aux discussions, qui en ont recruté d'autres, ex-étudiants plus ou moins chômeurs, étudiants d'autres institutions, et d'autres encore, bref qui ont créé un autre type d'hétérogénéité dans une situation toute différente : aucun objectif mobilisateur « naturel » même pas, et surtout pas, celui qu'auraient pu constituer les modalités de prolongation de la lutte universitaire, somme toute peu importante pour beaucoup de ceux qui cherchaient, en se rassemblant, à devenir « acteurs ».
Le sens de l'expérimentation s'est imposé dès que nous nous sommes retrouvés réunis « seuls » c'est-à-dire après le départ des « français ». Nous étions « comme avant », et pourtant quelque chose nous avait été transmis dont nous savions que le premier défi était qu'elle ne se perde pas, qu'elle fasse une différence. Mais quelle différence ? Comment actualiser ce qui s'était transmis ? Oui certes, le travail avec le laboratoire allait continuer : déjà une bonne dizaine d'entre nous est en partance pour un stage à Ville Evrard. Mais pour qu'un tel stage nourrisse quelque chose, il faut quelque chose à nourrir. Quoi ?
Chacun ne peut, en ce stade initial, que témoigner à sa manière de ce qui s'est passé. Les récits où l'un peut parler pour plus d'un ne se créent que plus tard, lorsque « ce qu'il y a » à raconter a pris existence. Je dirais donc que, pour moi, la qualité la plus singulière de l'expérimentation débutante a été la « patience », au sens où patience s'oppose à angoisse et urgence : comme si quelque chose nous « contenait », nous permettait de tolérer les silences, la perplexité, le savoir de ce que nous étions réunis « pour rien », sans mots d'ordre ni programme, et de ce que la chose normale serait de nous disperser et de reprendre le train-train de la vie « normale ». La question n'était pas du tout « que nous veulent-ils, ces français ». À sa manière, chacun le savait parfaitement. Ce qu'ils nous voulaient était d'ailleurs en fait, me semble-t-il, identiquement cela même qui nous « contenait », ensemble, hors de l'équilibre de nos habitudes, de nos impatiences angoissées, et de nos désespoirs. On pourrait le dire ainsi : ils ne sont pas venus « faire un spectacle » ; ils nous ont donné, avec largesse, sans compter, du temps, de l'attention, de la patience. Comme si c'était important,comme si nous importions. On ne donne pas sans créer d'obligation. Mais l'obligation, ici, n'est rien d'autre que d'admettre, ce qui n'est pas facile, que cela, en effet, importe. Ce qui nous contenait n'était donc autre que l'obligation de résister à la norme prévisible de la dispersion.
Cette question de « temps » m'intéresse. Si on se disperse, c'est toujours parce qu'on a l'impression de « perdre son temps ». « Pas de temps à perdre » ; « à quoi perdons-nous encore notre temps ! », sont des mots d'ordre d'autant plus redoutables qu'ils semblent émaner d'une exigence de liberté. Bien sûr, ils ne portent pas en général sur les bavardages au café, les « activités de loisir », toutes ces manières que nous avons de « faire passer le temps ». Ils portent sur les tentatives de « créer du social », de créer de nouvelles manières d'exister ensemble. C'est peut-être pourquoi, d'ailleurs, on s'ennuie tant aux réunions politiques militantes : il faut prouver par toutes sortes d'urgences qu'on ne perd pas son temps, c'est-à-dire par exemple se constituer un ordre du jour hyper-chargé qui donnera à chacun l'impression rassurante qu'il y a « du boulot à abattre ». Contraste très intéressant avec ce que nous savons des sociétés dites « traditionelles » de ces villages qui peuvent se mobiliser pendant plusieurs jours pour une cérémonie rituelle qui recrée des liens entre la communauté et un de ses membres en souffrance. Comme si cela importait, comme si c'était tout sauf du temps perdu. Ce qui, au fond, n'a rien d'exotique, pas plus cette exigence que l'on trouve dans L'Unité des différences, que le « devenir de l'entreprise » et de ceux qui la font ou la feront vivre deviennent l'une des matières du temps que l'on passe sur les « lieux de production ». C'est nous qui sommes exotiques, difficilement compréhensibles (quoique parfaitement explicables), lorsque nous jugeons normal et souhaitable de quitter le lieu de travail dès que possible et de déléguer la tâche de s'occuper de ceux qui en ont besoin à des spécialistes dont nous achetons le temps. Et bien sûr cela a un rapport avec la thèse que seraient jeunes « ceux qui luttent pour un présent qui ait de l'avenir ». Ceux qui sont « jeunes » sans avoir à lutter pour cela, les enfants, nous montrent cela : leurs jeux sont vitaux, les collectifs qu'ils ne cessent de créer sont le site de drames, d'espoirs, de joies, de désarrois, de violences inimaginables pour l'adulte.
Je demandais : « comment on fait pour se réveiller ? », une question qui fait écho un peu partout aujourd'hui.Génération Chaos nous oblige à reconnaître une condition sine qua non du processus : lutter contre l'impératif, intériorisé par chacun d'entre nous, de ne pas perdre son temps. Pour le reste, à Bruxelles, l'expérimentation continue, mais il est trop tôt pour qu'existent les mots qui me permettraient d'en parler au nom de plus d'un.