
Les périphériques vous parlent : Nous nous étions rencontrés à l’occasion d’un atelier que j’animais dans le cadre de l’Université d’été du mouvement d’éducation populaire “Peuple et Culture” consacrée aux inégalités sociales, et qui s’intitulait "Travail et intégration". Je vous avais sollicité pour intervenir sur la façon dont l’école traite cette question des inégalités sociales, ou encore des discriminations. Nous pourrions revenir sur la manière dont les systèmes éducatifs antérieurs se sont différemment saisis du problème des inégalités sociales, ou l’ont négligé, au nom de paradigmes pédagogiques reflétant une significative évolution des mentalités.
Laurent Ott : Il est tout d’abord important de revenir sur la manière dont l’égalité ou l’inégalité sont thématisées, ceci en partant de l’école, parce que c’est à partir de l’école que s’est développée une pensée qui a représenté une tentative de remédier à des inégalités qui, jadis, étaient conçues et perçues comme collectives, et qui maintenant sont de plus en plus perçues comme individuelles. Sans en revenir pour autant à Jules Ferry, on se rend compte que la question de l’inégalité - qui est à l’origine de l’enjeu actuel de l’égalité des chances - n’était absolument pas perçue de la même façon par le passé.
La pédagogie du modèle
La première période de l’école publique court du début du XXème siècle jusqu’à la première guerre mondiale. C’est une école de la réplication des classes sociales. Le but est de dispenser à chaque enfant une formation qui lui permette d’occuper la place qui lui revient à l’intérieur du tissu social : permettre à l’enfant de laboureur d’être un laboureur compétent, à l’enfant d’ouvrier d’être un ouvrier compétent, à l’enfant bourgeois aussi d’accéder à une position bourgeoise dans la société. Cette réplication des classes sociales est l’essence même de l’école, y compris dans ses modes de transmission qui visent la reproduction de modèles. On conçoit la norme et l’application de la norme, qu’elle soit pédagogique ou morale, comme étant le but de l’école, sans remise en cause possible. La norme fait consensus et répond au désir de chaque classe sociale, des familles et des enfants, de s’intégrer à un ordre hiérarchisé au sein duquel ils sont finalement amenés à prendre leur place.
L’école des meilleurs, le "révélationnisme" élitiste
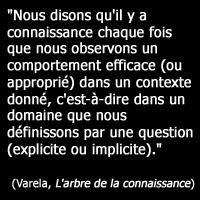
La première guerre mondiale entraînera une remise en cause complète de la société et, en particulier, de ses modes de domination. Des pédagogues comme Frenet reviendront blessés de la première guerre mondiale, avec une interrogation qui les animera toute leur vie : comment se fait-il que l’école forme des ânes ou des moutons dénués d’esprit critique qui s’en vont sans conteste se faire massacrer sur les champs de bataille ? On commence donc à assigner à l’école le rôle d’une éducation dotée d’esprit critique, comme se pose également la question du mérite en vertu de critères plus démocratiques. Ce qui compte est certes de repérer les meilleurs, mais les meilleurs n’appartiennent pas nécessairement aux classes bourgeoises, ils se logent également chez les paysans ou les ouvriers et ceux-là méritent justement les encouragements et le soutien de la nation. Qui dit mérite dit sélection, mais les perdants ou gagnants de l’école méritocratique n’envient nullement leur place respective, même après la fin de la deuxième guerre mondiale : ceux qui se destinent à des études courtes et rejoignent précocement le monde du travail ne s’estiment pas en situation "d’échec scolaire", ils considèrent que c’est là leur voie, conforme à leurs aspirations et vision de la vie.
L’après-guerre : épanouissement et "révélationnisme démocratique
À l’issue de la seconde guerre mondiale, le conseil de la Résistance élaborera tout un programme pédagogique qui se déploiera dans l’après-guerre. Ce programme aboutira en partie à la loi pour la protection de l’enfance de 1958. Il y a cette idée que la jeunesse est la richesse de la société, d’autant plus dans une France ravagée qu’il faut reconstruire. Ce pari sur la jeunesse, cet amour pour la jeunesse portés peu ou proue par les idéaux communistes, va conduire à un renversement complet de la vision méritocratique. Il ne s’agit plus de se demander qui sont les meilleurs, mais plutôt où réside le meilleur en chaque enfant et comment inciter chaque élève à atteindre le meilleur de lui-même pour le plein épanouissement des ses possibilités : c’est à ce moment là qu’on inventera l’échec scolaire. À l’origine il y a bien évidemment une ambition très généreuse pour une instruction de masse : celle de la singularisation de l’élève. Cependant, étant donné que les modèles de réussite restent inchangés, cette vision oublie ceux qui n’ont pas les moyens malgré tout de se hisser à l’excellence académique.

Les périphériques : Peut-on dire que la notion d’échec scolaire émerge au moment même où l’on postule un idéal de réussite ?
Laurent Ott : Oui, s’il n’y a pas d’idéal de réussite pour tous, il n’y a pas d’échec scolaire. De la même façon, au partir du moment où l’on formule un idéal de réussite sociale pour tous, on peut considérer que l’enfant qui n’y arrive pas est un enfant sous-réalisé, c’est-à-dire un enfant qui pourrait avoir le droit de se plaindre quant à la façon dont il aura été traité par l’école et l’environnement social. Cette nouvelle école, portée et voulue par Henri Valant, n’a pas modifié les pratiques d’une façon suffisamment rapide. Il s’est produit une survivance de l’ancien système co-existant avec les idéaux du nouveau système émanant des années ‘50 et ’60. À la fin des années ’60 et au début des années ’70 l’école connaît un véritable printemps, et on commence à penser que son rôle n’est pas seulement d’instruire mais aussi d’éduquer et d’éveiller : c’est la grande période des pédagogies de l’éveil, de l’épanouissement de l’enfant, de l’ouverture sur le monde. C’est une période où on encourage officiellement les enseignants à sortir du fortin des classes, à organiser des séjours culturels, des classes de découverte, des activités en plein air. Ce sera un âge d’or, en tout cas pour l’école élémentaire, une ouverture vers un idéal d’épanouissement des potentiels de l’enfant dans son environnement immédiat, mais également dans la société en tant qu’enfant acteur et constructeur. C’est là un mouvement assez important, mais qui ne s’est malgré tout développé que très lentement, compte tenu des obstacles et de la persistance d’archaïsmes. Ce nouvel esprit évoluera ensuite à partir de la victoire de la gauche en 1981 avec le ministère de l’éducation nationale d’Alain Savary et surtout après, avec le deuxième ministère de l’éducation nationale de la gauche confié à Jean-Pierre Chevènement, impulsant un changement radical d’orientation scolaire qui viendra complètement annihiler la logique précédente. À partir de 1994, Mr Chevènement publie de nouvelles instructions d’orientations officielles en format poche, chose inhabituelle, afin d’amener à une véritable communication sociale sur le rôle de l’école : un nouveau mode de gouvernance à travers l’école. Les mots d’ordre lancés à la société sont simples : le but de l’école n’est pas d’éduquer les enfants ou de les épanouir mais de les instruire. L’instruction, elle, correspond aux savoirs les plus fondamentaux, aux plus basiques, aux opérations du type "lire-écrire-compter-calculer".
Médicalisation et pédagogies du raidissement
Les périphériques : N’en revient-on pas alors à une conception proche de celle de Jules Ferry ?
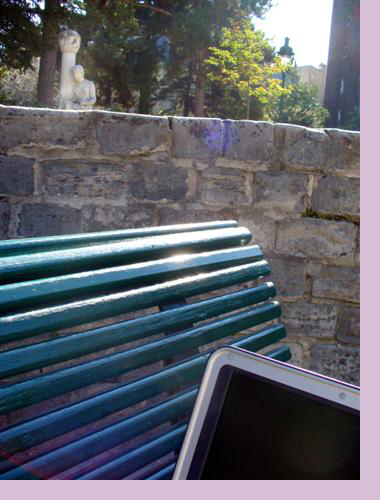
Laurent Ott : Oui, mais avec un anachronisme, car Jules Ferry en son temps pouvait être considéré comme un éducateur en assignant à l’école, un rôle de transmission de valeurs, de modes d’organisation du travail. Disons qu’avec ce ministère commence à se formuler l’idée que les enfants apprennent mal, victimes d’une conception libertaire de l’éducation défendue par leurs parents ; et que l’éveil ou la liberté conduisent également à l’irrévérence. En 1994, on commence à esquisser une équation entre le fait pour les élèves de ne plus suffisamment intégrer les fondamentaux scolaires et la délinquance. On commence aussi à intenter un procès aux parents, à les accuser d’incompétence et de ne pas inculquer aux enfants des préalables requis. Evidemment ce changement a été conditionné par une métamorphose socio-économique, en l’occurrence la persistance d’une période de chômage de masse : il fallait effectivement que l’école réponde à certaines préoccupations de la société, notamment le chômage et l’insécurité. Il n’est pas indifférent que le même Jean-Pierre Chevènement deviendra ensuite Ministre de l’Intérieur, incarnant une sorte de Sarkozysme avant l’heure et introduisant tous les termes du débat que nous connaissons maintenant. Donc, à partir de 1994, nous avons une école qui préconise, au moins en théorie, un objectif de masse (amener tous les enfants au niveau le meilleur possible d’éducation), mais avec cette idée qu’il va falloir détecter et traiter tous les élèves susceptibles de devenir source de problèmes.
À la logique "un enfant qui ne réussit pas est un enfant sous-réalisé" succède cette autre logique : "si un enfant ne se réalise pas, c’est probablement parce qu’on n’aura pas été assez attentif à tous les problèmes qu’il a rencontrés : sociaux, familiaux et cognitifs". On est passé d’un registre méritocratique à un registre médical. L’idée est de repérer les inadaptations et les troubles. Cela ne s’est pas passé du jour au lendemain, mais déjà dans les instructions officielles de 1994 on insiste énormément sur la place des orthophonistes pour repérer les troubles du langage, dépister précocement les difficultés de l’apprentissage de la lecture : il y a cette idée que la source de la difficulté est individuelle. Plus un problème devient massif, plus il faut absolument pouvoir l’expliquer individuellement. Plus un problème devient important à l’échelle de la société, plus il faut lui trouver des réponses et des explications individuelles.

Le paradigme Chevènement appauvrit ainsi l’école dans ses missions parce qu’il instaure une vision extrêmement étriquée qui ne permet pas d’aider les enfants à devenir des acteurs sociaux reconnus et compétents. Il s’agit d’apporter aux enfants des micro-savoirs déterminés par des programmes et des évaluations nationales qui vont se multiplier par la suite. Aujourd’hui d’ailleurs, on a le sentiment que l’école sert davantage à préparer les évaluations qui mesurent sa propre efficacité qu’à autre chose. Cet appauvrissement de l’école va de pair avec sa sacralisation. La référence aux anciens, aux sages, aux classiques accuse ce trait. Peu à peu s’ébauche l’idée que l’école est un sanctuaire, que la culture nous sauvera de la barbarie, alors que l’histoire démontre que culture et barbarie font très bon ménage. On érige en même temps l’école comme le cœur de la vie familiale, exhortant les parents à agir de telle manière que leurs enfants deviennent de bons élèves, comme si les premiers se devaient d’être les auxiliaires des enseignants.
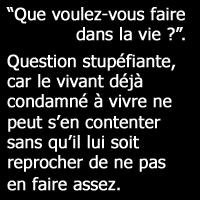 Cette sacralisation de l’école est destinée aussi à justifier la coupure entre le système scolaire et la société : coupure matérielle, physique, humaine de l’école renforcée par des mesures de protection de type Vigipirate. On oublie et abandonne alors tout ce qui touche à l’éducation, à l’animation, à la pédagogie de groupe, à l’acte d’enseigner et aux méthodes actives. On redécouvre avec émerveillement les vieilles méthodes qui n’avaient jamais fait leur preuve. C’est durant cette période des années ’90 que s’inscrit la lutte contre l’échec scolaire afin de redonner à tous les enfants leur chance et qu’on met en place les Zones d’Education Prioritaire. Les premières politiques de ZEP ont eu pour effet de mobiliser l’action municipale ou associative autour du fonctionnement de l’école.
Cette sacralisation de l’école est destinée aussi à justifier la coupure entre le système scolaire et la société : coupure matérielle, physique, humaine de l’école renforcée par des mesures de protection de type Vigipirate. On oublie et abandonne alors tout ce qui touche à l’éducation, à l’animation, à la pédagogie de groupe, à l’acte d’enseigner et aux méthodes actives. On redécouvre avec émerveillement les vieilles méthodes qui n’avaient jamais fait leur preuve. C’est durant cette période des années ’90 que s’inscrit la lutte contre l’échec scolaire afin de redonner à tous les enfants leur chance et qu’on met en place les Zones d’Education Prioritaire. Les premières politiques de ZEP ont eu pour effet de mobiliser l’action municipale ou associative autour du fonctionnement de l’école.
L’enseignant et la violence scolaire
Les périphériques : N’était-ce pas une idée généreuse à la base ?
Laurent Ott : Oui, mais elle mobilise des savoirs aux effets discriminants. On confie à des opérateurs externes le soin de prendre en charge des problèmes ou des pathologies qu’on ne souhaite pas traiter ou prendre en considération dans le parcours d’un élève (les ruptures familiales, l’instabilité et la difficulté de la vie moderne, la monoparentalité, les difficultés éducatives, la précarité, les problèmes de papiers) y compris aussi la tristesse de l’enfant, sa dépression éventuelle. L’école désigne l’environnement extérieur comme responsable de tous ses maux en son sein et invite ses partenaires à venir au chevet d’un système qui se dit malade de la violence, du chômage et du déficit d’intégration des populations immigrées. Cette mobilisation n’a pas pour but un débat social, dans un cadre de participation. L’école assigne chacun à un rôle à ne pas transgresser et fait peser sur les parents des contraintes lourdes : convocations, suspension des allocations familiales, retrait des bulletins de note en mains propres, justification des absences de leur enfant par sms.
Les périphériques : On assiste d’ailleurs à une dépolitisation de la question éducative, notamment sur le versant des inégalités sociales à l’avantage d’un discours moral parant à la prolifération des incivilités, et très loquace sur le thème de la violence à l’école débouchant récemment sur la latitude récente accordée aux forces de l’ordre pour intervenir dans les lycées. Ceci dit, les enseignants sont confrontés à des situations délicates, immergés dans des zones dites sensibles où le travail de l’enseignant devient très périlleux sinon parfois dangereux. Comment alors démêler le vrai du faux ?
Laurent Ott : Il existe une grande souffrance des enseignants même si ces derniers s’organisent, constituent des équipes, mettent en œuvre des pratiques en phase avec les milieux sociaux fragilisés. Mais ce type d’initiative est souvent découragé par les Institutions ; le sont également des approches et des réponses plus pédagogiques que répressives à une détresse sociale qui se traduit par la violence scolaire. Ce qui n’empêche pas les enseignants d’être désorientés par les difficultés qu’ils rencontrent. D’abord parce qu’eux-mêmes n’ont jamais été en conflit avec l’institution scolaire au regard de leur condition sociale. D’autre part, ils ont la certitude que la mission de l’école est d’une telle évidence qu’elle ne peut être contestée ou chahutée. Et leur Ministère de tutelle les conforte dans cette évidence. Mr Chevènement a été l’un des premiers à avoir flatté l’enseignant sur sa mission en expliquant toute l’admiration qu’il leur portait. Une majorité d’enseignants est donc hantée par le rêve, la nostalgie, le phantasme du cours magistral dispensé sans entrave. Il s’agit là d’un certain imaginaire du métier d’enseignant qui se perpétue, parce que la formation professionnelle des enseignants ne leur permet pas de la mettre en cause et d’apprendre un nouveau métier qui serait un métier complètement différent.
Il y a un autre problème, à savoir que les enseignants adoptent des modalités de transmission complètement inadaptées aux besoins des adolescents d’aujourd’hui, et qui ne favorisent guère tout un travail de reconstruction du désir d’apprendre, du désir de l’expression de soi, du travail collectif, de façon à ce que le collectif justement ne soit pas perçu finalement comme une source de mal-être, de concurrence, de sarcasme, de moquerie, de violence, de sanction. Donc, effectivement chaque enseignant, pris isolément, baigne dans un sentiment d’impuissance ; souvent même il a l’impression qu’il se bat pour sa peau avec des méthodes employées pour se protéger qui alimentent le malaise (mais qui lui paraissent être les seules possibles), le ressentiment des enfants et des adolescents eux-mêmes.
Egalité des chances et inégalité de résultat
Les périphériques : Que diriez-vous de cette notion très en vogue d’égalité des chances ?
Laurent Ott : Certains auteurs ont réfléchi à cette formule qui laisse la porte ouverte à l’inégalité de résultat : chacun peut saisir sa chance, certains y parviennent, d’autres non. Chacun doit faire en sorte de travailler à sa propre assomption sociale. Ceux qui n’y parviendront pas sont dans une situation d’échec qui nous conforte finalement dans l’idée que les inégalités sociales sont inéluctables. Il y a quelque chose de très insidieux dans cette formule. Nous donnons à tous une chance, certains réussissent, d’autres échouent, mais nous avons permis à tout le monde de réussir. Cela veut dire que certains n’ont pas su saisir cette chance qu’on leur offrait cependant.
La notion égalité des chances, c’est effectivement l’idéal de retrouver une inégalité qui serait résiduelle et réduite à ce qu’il y a de plus acceptable : une juste inégalité en somme. Il est clair qu’à une époque les enfants de bourgeois ou d’ouvriers ne faisaient pas les mêmes études, mais au moins avaient-ils chacun l’impression de s’insérer dans une communauté qui leur reconnaissait une identité. Aujourd’hui l’inégalité dans l’égalité des chances revêt l’aspect d’un drame individuel qui renvoie l’individu à ses tares, ses manques et ses handicaps, à un face à face avec sa propre incompétence. D’une certaine façon le traitement par l’égalité des chances vise à désamorcer à la fois la bombe sociale et la bombe scolaire, en structurant l’impossibilité d’une réaction collective vis-à-vis des inégalités sociales et en renforçant l’idée de l’individualisation des parcours éducatifs.

On invoquera également des incompétences parentales, qui pourront dédouaner la collectivité ou l’institution de l’échec d’un élève, et/ou, sur le plan médical (en attendant le retour de la sociobiologie), on recherchera dans une prédestination quelque peu génétique les fragilités des uns et des autres. En fait, on naturalise les inégalités et en même temps on les porte à la charge de la famille dans un contexte de médicalisation et de judiciarisation des difficultés scolaires.
Propos recueillis par Yovan Gilles et Gaïa Puliero
Haut de page
Sommaire